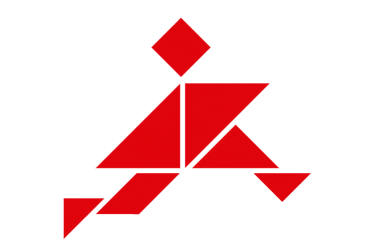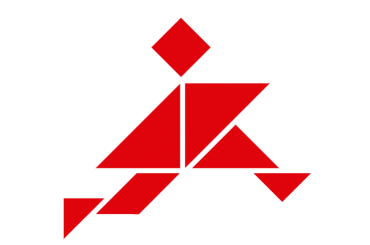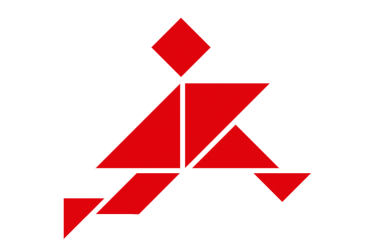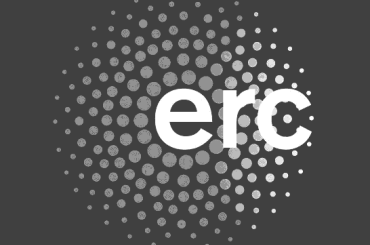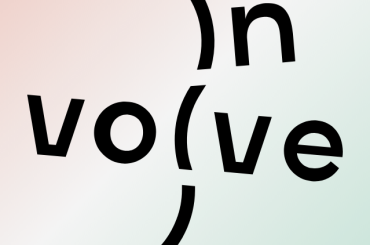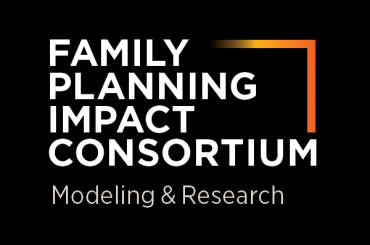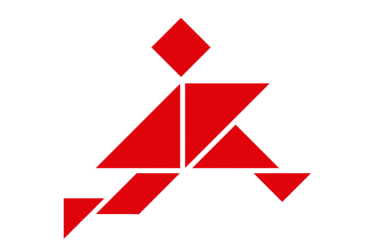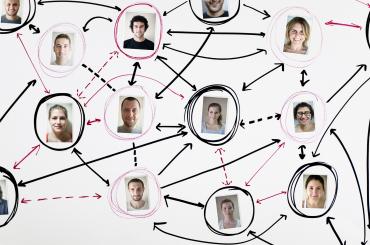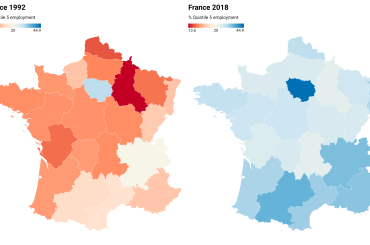Daily LIVES
Dirigé par : Caroline Roberts et Jimena Sobrino Piazza
Des chercheur·ses du Centre LIVES et du Centre suisse de compétence en sciences sociales (FORS) collaborent depuis 2023 sur des travaux de recherche et de développement visant à étudier les défis méthodologiques de la conduite d'enquêtes sur l'utilisation du temps (Time Use Surveys - TUS) en ligne. Les TUS, qui visent à mesurer le temps que les individus consacrent à diverses activités, sont traditionnellement réalisées par les instituts nationaux de la statistique avec l'aide d'interviewer·euse·s et de « Journaux d'emploi du temps » papier-crayon.
Des chercheur·ses du Centre LIVES et du Centre suisse de compétence en sciences sociales (FORS) collaborent depuis 2023 sur des travaux de recherche et de développement visant à étudier les défis méthodologiques de la conduite d'enquêtes sur l'utilisation du temps (Time Use Surveys - TUS) en ligne. Les TUS, qui visent à mesurer le temps que les individus consacrent à diverses activités, sont traditionnellement réalisées par les instituts nationaux de la statistique avec l'aide d'interviewer·euse·s et de « Journaux d'emploi du temps » papier-crayon.